
- Juliette Drouet en femme de Smyrne, vers 1827. Huile sur toile de Charles-Emile de Champmartin. © Maison Victor Hugo Paris.
En 1827, Scipion Pinel (fils du célèbre aliéniste) s’endette pour couvrir Juliette Drouet de cadeaux. L’année suivante, poursuivi par la justice, il fuit quelque temps en Allemagne. Elle l’accompagne d’abord, puis le quitte et fait ses débuts d’actrice à Bruxelles, au Théâtre du Parc, en décembre 1828. En juillet 1829, elle joue à Paris, au Théâtre du Vaudeville, puis à la Porte-Saint-Martin et à l’Odéon. Femme splendide, actrice admirée pour sa beauté, plus que pour son talent inégal, elle mène grand train, mais doit faire face à la justice qui la poursuit après qu’elle s’est portée caution des dettes de Scipion Pinel en 1830. Elle fréquente le journaliste Alphonse Karr, qui lui promet le mariage et profite de son argent.
Lors des répétitions de Lucrèce Borgia à la Porte-Saint-Martin, elle devient la maîtresse de Victor Hugo. Leur première nuit d’amour (du 16 au 17 février 1833) sera par la suite célébrée chaque année dans le livre rouge où Juliette Drouet collectionne l’hommage rituel de Hugo. Il célébrera aussi cette date dans Les Misérables, où elle deviendra le jour du mariage de Marius et Cosette. Les débuts de leur liaison sont orageux et passionnés. En novembre 1833, Juliette Drouet ne joue qu’un soir, celui de la première de Marie Tudor, le rôle de Jane que Hugo a écrit pour elle. Ayant perdu tous ses moyens, elle est aussitôt remplacée. Elle ne se remettra jamais de cet échec, après lequel elle ne jouera pratiquement plus jamais. Engagée comme pensionnaire à la Comédie-Française, elle y reste deux ans sans être jamais distribuée. Son renoncement au métier d’actrice se précise quand, en 1838, lui échappe le rôle de la Reine de Ruy Blas, écrit pour elle, et qu’elle avait appris par cœur.
Dans la nuit du 17 au 18 novembre 1839, Juliette et Victor célèbrent leur « mariage » mystique, par lequel elle renonce à sa carrière d’actrice et reçoit l’assurance qu’il ne l’abandonnera jamais. Promesse tenue. Les ennemis de Hugo voient dans cette relation adultère durable une forme scandaleuse de « bigamie ». Une fois élu à l’Académie Française, en 1841, Hugo mène une vie publique et mondaine qui contribue à l’éloigner de Juliette Drouet, à qui la solitude et la réclusion pèsent de plus en plus. Les voyages qu’elle accomplit avec lui sont pour elle des périodes privilégiées et réparatrices. Celui de l’été 1843 se termine tragiquement : à Rochefort, elle voit Hugo apprendre par le journal la mort de Léopoldine. Elle consigne les notes de leur voyage de retour. La même année, Hugo rencontre Léonie Biard ; il noue avec elle une liaison durable qu’il réussit à cacher à Juliette Drouet ; cette jeune femme blonde qu’est Léonie, le distrait de sa tristesse et lui redonne une joie de vivre, il l'appelle son "ange".
Claire Pradier à 15 ou 16 ans. Croquis de James Pradier, vers 1842. © Collection particulière.
Sa fille Claire, que Juliette prénomme clairon ou péronnelle, est élevée en pension à Saint-Mandé, de santé fragile, elle échoue plusieurs fois à l’examen pour devenir institutrice. Elle meurt en 1846 de tuberculose, 3ans après Léopoldine Hugo. Victor Hugo qui considérait Claire comme sa propre fille, lui dédia plusieurs poèmes :
Quel âge hier ? Vingt ans. Et quel âge aujourd’hui ?
L’éternité. Ce front pendant une heure a lui.
Elle avait les doux chants et les grâces superbes ;
Elle semblait porter de radieuses gerbes ;
Rien qu’à la voir passer, on lui disait : Merci !
Qu’est-ce donc que la vie, hélas ! pour mettre ainsi
Les êtres les plus purs et les meilleurs en fuite ?
Et, moi, je l’avais vue encor toute petite.
Elle me disait vous, et je lui disais tu.
Claire
Quoi donc ! la vôtre aussi ! la vôtre suit la mienne !
O mère au coeur profond, mère, vous avez beau
Laisser la porte ouverte afin qu'elle revienne,
Cette pierre là-bas dans l'herbe est un tombeau !
La mienne disparut dans les flots qui se mêlent ;
Alors, ce fut ton tour, Claire, et tu t'envolas.
Est-ce donc que là-haut dans l'ombre elles s'appellent,
Qu'elles s'en vont ainsi l'une après l'autre, hélas ?
Enfant qui rayonnais, qui chassais la tristesse,
Que ta mère jadis berçait de sa chanson,
Qui d'abord la charmas avec ta petitesse
Et plus tard lui remplis de clarté l'horizon,
Voilà donc que tu dors sous cette pierre grise !
Voilà que tu n'es plus, ayant à peine été !
L'astre attire le lys, et te voilà reprise,
O vierge, par l'azur, cette virginité !
Te voilà remontée au firmament sublime,
Échappée aux grands cieux comme la grive aux bois,
Et, flamme, aile, hymne, odeur, replongée à l'abîme
Des rayons, des amours, des parfums et des voix !
Nous ne t'entendrons plus rire en notre nuit noire.
Nous voyons seulement, comme pour nous bénir,
Errer dans notre ciel et dans notre mémoire
Ta figure, nuage, et ton nom, souvenir !
Pressentais-tu déjà ton sombre épithalame ?
Marchant sur notre monde à pas silencieux,
De tous les idéals tu composais ton âme,
Comme si tu faisais un bouquet pour les cieux !
En te voyant si calme et toute lumineuse,
Les coeurs les plus saignants ne haïssaient plus rien.
Tu passais parmi nous comme Ruth la glaneuse ,
Et, comme Ruth l'épi, tu ramassais le bien.
La nature, ô front pur, versait sur toi sa grâce,
L'aurore sa candeur, et les champs leur bonté ;
Et nous retrouvions, nous sur qui la douleur passe,
Toute cette douceur dans toute ta beauté !
Chaste, elle paraissait ne pas être autre chose
Que la forme qui sort des cieux éblouissants ;
Et de tous les rosiers elle semblait la rose,
Et de tous les amours elle semblait l'encens.
Ceux qui n'ont pas connu cette charmante fille
Ne peuvent pas savoir ce qu'était ce regard
Transparent comme l'eau qui s'égaie et qui brille
Quand l'étoile surgit sur l'océan hagard.
Elle était simple, franche, humble, naïve et bonne ;
Chantant à demi-voix son chant d'illusion,
Ayant je ne sais quoi dans toute sa personne
De vague et de lointain comme la vision.
On sentait qu'elle avait peu de temps sur la terre,
Qu'elle n'apparaissait que pour s'évanouir,
Et qu'elle acceptait peu sa vie involontaire ;
Et la tombe semblait par moments l'éblouir.
Elle a passé dans l'ombre où l'homme se résigne ;
Le vent sombre soufflait ; elle a passé sans bruit,
Belle, candide, ainsi qu'une plume de cygne
Qui reste blanche, même en traversant la nuit !
Elle s'en est allée à l'aube qui se lève,
Lueur dans le matin, vertu dans le ciel bleu,
Bouche qui n'a connu que le baiser du rêve,
Ame qui n'a dormi que dans le lit de Dieu !
Nous voici maintenant en proie aux deuils sans bornes,
Mère, à genoux tous deux sur des cercueils sacrés,
Regardant à jamais dans les ténèbres mornes
La disparition des êtres adorés !
Croire qu'ils resteraient ! quel songe ! Dieu les presse.
Même quand leurs bras blancs sont autour de nos cous,
Un vent du ciel profond fait frissonner sans cesse
Ces fantômes charmants que nous croyons à nous.
Ils sont là, près de nous, jouant sur notre route ;
Ils ne dédaignent pas notre soleil obscur,
Et derrière eux, et sans que leur candeur s'en doute,
Leurs ailes font parfois de l'ombre sur le mur.
Ils viennent sous nos toits ; avec nous ils demeurent ;
Nous leur disons : Ma fille, ou : Mon fils ; ils sont doux,
Riants, joyeux, nous font une caresse, et meurent. -
O mère, ce sont là les anges, voyez-vous !
C'est une volonté du sort, pour nous sévère,
Qu'ils rentrent vite au ciel resté pour eux ouvert ;
Et qu'avant d'avoir mis leur lèvre à notre verre,
Avant d'avoir rien fait et d'avoir rien souffert,
Ils partent radieux ; et qu'ignorant l'envie,
L'erreur, l'orgueil, le mal, la haine, la douleur,
Tous ces êtres bénis s'envolent de la vie
A l'âge où la prunelle innocente est en fleur !
Nous qui sommes démons ou qui sommes apôtres,
Nous devons travailler, attendre, préparer ;
Pensifs, nous expions pour nous-même ou pour d'autres ;
Notre chair doit saigner, nos yeux doivent pleurer.
Eux, ils sont l'air qui fuit, l'oiseau qui ne se pose
Qu'un instant, le soupir qui vole, avril vermeil
Qui brille et passe ; ils sont le parfum de la rose
Qui va rejoindre aux cieux le rayon du soleil !
Ils ont ce grand dégoût mystérieux de l'âme
Pour notre chair coupable et pour notre destin ;
Ils ont, êtres rêveurs qu'un autre azur réclame,
Je ne sais quelle soif de mourir le matin !
Ils sont l'étoile d'or se couchant dans l'aurore,
Mourant pour nous, naissant pour l'autre firmament ;
Car la mort, quand un astre en son sein vient éclore,
Continue, au delà, l'épanouissement !
Oui, mère, ce sont là les élus du mystère,
Les envoyés divins, les ailés, les vainqueurs,
A qui Dieu n'a permis que d'effleurer la terre
Pour faire un peu de joie à quelques pauvres coeurs.
Comme l'ange à Jacob, comme Jésus à Pierre,
Ils viennent jusqu'à nous qui loin d'eux étouffons,
Beaux, purs, et chacun d'eux portant sous sa paupière
La sereine clarté des paradis profonds.
Puis, quand ils ont, pieux, baisé toutes nos plaies,
Pansé notre douleur, azuré nos raisons,
Et fait luire un moment l'aube à travers nos claies,
Et chanté la chanson du ciel dam nos maisons,
Ils retournent là-haut parler à Dieu des hommes,
Et, pour lui faire voir quel est notre chemin,
Tout ce que nous souffrons et tout ce que nous sommes,
S'en vont avec un peu de terre dans la main.
Ils s'en vont ; c'est tantôt l'éclair qui les emporte,
Tantôt un mal plus fort que nos soins superflus.
Alors, nous, pâles, froids, l'oeil fixé sur la porte,
Nous ne savons plus rien, sinon qu'ils ne sont plus.
Nous disons : - A quoi bon l'âtre sans étincelles ?
A quoi bon la maison où ne sont plus leurs pas ?
A quoi bon la ramée où ne sont plus les ailes ?
Qui donc attendons-nous s'ils ne reviendront pas ? -
Ils sont partis, pareils au bruit qui sort des lyres.
Et nous restons là, seuls, près du gouffre où tout fuit,
Tristes ; et la lueur de leurs charmants sourires
Parfois nous apparaît vaguement dans la nuit.
Car ils sont revenus, et c'est là le mystère ;
Nous entendons quelqu'un flotter, un souffle errer,
Des robes effleurer notre seuil solitaire,
Et cela fait alors que nous pouvons pleurer.
Nous sentons frissonner leurs cheveux dans notre ombre ;
Nous sentons, lorsqu'ayant la lassitude en nous,
Nous nous levons après quelque prière sombre,
Leurs blanches mains toucher doucement nos genoux.
Ils nous disent tout bas de leur voix la plus tendre :
"Mon père, encore un peu ! ma mère, encore un jour !
"M'entends-tu ? je suis là, je reste pour t'attendre
"Sur l'échelon d'en bas de l'échelle d'amour.
"Je t'attends pour pouvoir nous en aller ensemble.
"Cette vie est amère, et tu vas en sortir.
"Pauvre coeur, ne crains rien, Dieu vit ! la mort rassemble.
"Tu redeviendras ange ayant été martyr."
Oh ! quand donc viendrez-vous ? Vous retrouver, c'est naître.
Quand verrons-nous, ainsi qu'un idéal flambeau,
La douce étoile mort, rayonnante, apparaître
A ce noir horizon qu'on nomme le tombeau ?
Quand nous en irons-nous où vous êtes, colombes !
Où sont les enfants morts et les printemps enfuis,
Et tous les chers amours dont nous sommes les tombes,
Et toutes les clartés dont nous sommes les nuits ?
Vers ce grand ciel clément où sont tous les dictames,
Les aimés, les absents, les êtres purs et doux,
Les baisers des esprits et les regards des âmes,
Quand nous en irons-nous ? quand nous en irons-nous ?
Quand nous en irons-nous où sont l'aube et la foudre ?
Quand verrons-nous, déjà libres, hommes encor,
Notre chair ténébreuse en rayons se dissoudre,
Et nos pieds faits de nuit éclore en ailes d'or ?
Quand nous enfuirons-nous dans la joie infinie
Où les hymnes vivants sont des anges voilés,
Où l'on voit, à travers l'azur de l'harmonie,
La strophe bleue errer sur les luths étoilés ?
Quand viendrez-vous chercher notre humble coeur qui sombre ?
Quand nous reprendrez-vous à ce monde charnel,
Pour nous bercer ensemble aux profondeurs de l'ombre,
Sous l'éblouissement du regard éternel ?
Pendant la Révolution de 1848, Juliette est inquiète des troubles politiques ; elle s’habitue aux idéaux de la République, tout en redoutant le « spectre rouge ».
En 1851, Hugo ayant refusé de quitter Juliette pour elle, Léonie Biard envoie à sa rivale les lettres d’amour qu’il lui a adressées depuis des années. Juliette est plongée dans un profond désespoir, auquel se mêle l’émerveillement d’avoir été choisie aux dépens d’une femme plus jeune, plus désirable et plus brillante qu’elle. Elle transcende son chagrin dans le dévouement dont elle fait preuve en décembre 1851, trouvant à Hugo diverses cachettes qui lui sauvent la vie. Elle lui fournit l’habit et le passeport d’un de ses amis, l’ouvrier Lanvin, grâce auxquels Hugo passe clandestinement la frontière franco-belge. Elle le rejoint à Bruxelles, puis le suit à Jersey en août 1852, et à Guernesey fin 1855. Contrairement à la femme et aux enfants de Hugo, qui alternent les séjours à ses côtés et des retours en France et en Belgique, Juliette Drouet reste toujours auprès de lui. Elle habite plusieurs logements successifs, à proximité de Hugo. En novembre 1856, elle emménage à La Fallue, d’où elle peut apercevoir Hugo à son balcon, et communiquer avec lui à distance dès le matin. En 1864, ils achètent pour elle Hauteville-Fairy. Sa vie en exil est paradoxalement assez sereine : Hugo est plus disponible pour elle qu’il ne l’était à Paris. Les journées de Juliette sont ponctuées par son ménage, les promenades avec Hugo quand le temps le permet, la préparation de leurs dîners en tête à tête, ou avec François-Victor (des enfants de Hugo celui avec lequel elle a un rapport privilégié), ou avec quelques amis choisis, et sa « copire », comme elle dit, cette activité de copiste, commencée avant l’exil, qui lui tient à cœur, parce qu’elle lui permet de se sentir utile.
Elle dépouille les journaux, écrit son courrier, notamment à sa famille restée en France : sa sœur Renée-Françoise, son beau-frère Louis Koch, et leur fils Louis, marié à Ottilie Snell depuis 1841 ; ils manifestent régulièrement leur admiration à Hugo, qui leur fait bon accueil. Juliette Drouet se montre farouche avec la population de l’île, voulant préserver sa réputation en évitant le « cant », le qu’en-dira-ton : elle prend soin de ne pas fréquenter les amis de Mme Hugo, et se tient à l’écart de Hauteville-House. Néanmoins, en décembre 1864, pour le Christmasdes enfants pauvres organisé à Hauteville-House, Mme Hugo invite Juliette à se joindre à leur fête. Juliette, digne et discrète, décline l’invitation, mais répond : « La fête, Madame, c’est vous qui me la donnez. […] ». Dans une disposition testamentaire, Mme Hugo recommande à ses fils de ne pas abandonner Mme Drouet.
Double portrait de Juliette Drouet, 1868, Guémar frères, Bruxelles. D’après Arsène Garnier. © Collection particulière.
Après la mort de Mme Hugo, en 1868, Juliette Drouet continue à vivre quelques années de son côté, avant d’emménager à Paris sous le même toit que Hugo à partir de l’été 1873. Elle assure l’intendance, travail d’autant plus prenant que Hugo reçoit souvent de nombreuses tablées, les personnalités politiques et artistiques se pressant chez lui, et devient sa secrétaire particulière, dépouillant son abondant courrier. Les années passant, elle finit par se résigner à ce que Hugo ne se puisse guérir de ce qu’elle nomme sa « plaie vive de la femme », non sans chagrins;
Elle reçoit sa part de bonheur dans la fréquentation joyeuse des petits-enfants de Hugo, Georges et Jeanne, qui la surnomment « Roumé ».
Juliette Drouet, Victor Hugo et Jeanne
Elle meurt le 11 mai 1883, d’un cancer de l’estomac qui la faisait beaucoup souffrir depuis des années. Son entourage dissuade Hugo d’assister aux obsèques, qui ont lieu le lendemain. C’est Auguste Vacquerie qui prononce son éloge funèbre.
Juliette Drouet en 1883. Huile sur toile de Jules Bastien-Lepage. © Maison Victor Hugo Paris.
Juliette Drouet a écrit plus de 20000 lettres à Victor Hugo. Ce corpus immense regorge d’indications sur leur vie quotidienne et sur les relations de Hugo avec son entourage. Écrites le plus souvent à sens unique ( passés les premiers temps de la relation, Hugo adresse plutôt à Juliette des hommages rituels pour sa fête, son anniversaire, la commémoration de leur première nuit, le jour de l’an…), ces lettres quotidiennes, voire pluriquotidiennes, s’interrompent pendant les périodes où ils voyagent ensemble. Elles relèvent tout autant du journal personnel que de la correspondance, comme en témoigne le surnom que leur donne Juliette Drouet : chaque jour, sa « restitus » rend compte de son emploi du temps, de son état d’âme et de ses préoccupations, au premier rang desquels se trouvent la santé, son amour, sa reconnaissance, son admiration et sa jalousie, et sa fierté d’être, par le biais de la « copire » que Hugo lui donne à accomplir tant que ses yeux le lui permettent, sa première lectrice.
20 mars [1836], dimanche matin, 7 h. ½
Bonjour cher adoré, comment va ta petite gorge ce matin ? Je voudrais bien le savoir pour me réjouir si elle est guérie, ou pour te plaindre du fond de mon cœur si elle est toujours malade. Quant à moi je suis toujours dans le même état et je ne m’en plaindrais pas si j’étais sûre que cela deviendrait par la suite un bon gros et joli enfant qui vous ressemblerait. Mais, mais… rien n’est moins sûr et je me tiens dans une superbe indifférence sur ce petit incident pour n’avoir pas à pleurer une déception ce soir ou demain.
Il fait un temps ravissant. Je me suis levée de très bonne heure pour pouvoir vous écrire plus tôt. J’ai encore fait de méchants rêves et cependant jamais je n’avais été plus heureuse dans tes bras qu’hier au soir. Mais dès que tu t’éloignes de moi, je retombe au pouvoir des idées tristes. Tu vois bien que tu ne devrais jamais t’éloigner pour notre bonheur à tous les deux et pour ma tranquillité en particulier.
Mon cher petit Toto, je vous aime. Je ne sais pas comment ça se fait, mais je vous aime de plus en plus fort, quoique je vous aie aimé de toutes mes forces le premier jour où je vous ai vu. Au reste, je ne charge pas d’expliquer ce phénomène, je le sens et voilà tout ce qu’il me faut.
En attendant que tu viennes, je t’envoie mon cœur, ma pensée et mes baisers pour hâter ton retour.
Juliette
BnF, Mss, NAF 16326, f. 211-212
Transcription d’André Maget assisté de Guy Rosa
Paris, 31 décembre 1877, lundi soir, 7 h. ½
Cher bien-aimé, les bonnes grâces de fin d’année et les cadeaux princiers de nos hôtes, loin de me distraire de mon idée fixe : ma petite lettre à mon réveil demain matin, ne font qu’aviver encore, si c’est possible, l’impatience que j’ai de couvrir de baisers cette nouvelle chère lettre annuelle, bien venue d’avance, bien ardemment attendue pendant trois [cent] soixante-cinq jours et bénie de confiance bien religieusement.
J’espère qu’elle ne te coûtera pas trop à faire puisque tu n’as qu’à regarder comme moi dans ton cher grand cœur pour y voir le trésor d’amour que j’y ai enfoui depuis quarante-cinq ans bientôt.
Je suis bien contente que Mme Lockroy nous fasse déjeuner et dîner demain avec Georgeset avec Jeanne. La présence de ces deux êtres adorables et adorés ne peut que nous porter bonheur pour toute l’année. Qu’ils soient bénis ainsi que toi dont je baise les pieds avec dévotion.
Juliette
BnF, Mss, NAF 16398, f. 354
Transcription de Guy Rosa
Source juliettedrouet.org
Juliette Drouet et sa fille Claire Pradier reposent au cimetière de Saint Mandé (Val de Marne), côte à côte sous deux dalles ornées de vers de Hugo :
pour Juliette
Quand je ne serai plus qu’une cendre glacée,
Quand mes yeux fatigués seront fermés au jour,
Dis toi, si dans mon cœur, ma mémoire est fixée,
Le monde a sa pensée.
Moi j’avais son amour.
Voilà donc que tu dors sous cette pierre grise,
Voilà que tu n’es plus ayant à peine été !
L’astre attire le lys et te voilà reprise,
O Vierge, par l’azur, cette virginité !
Informations trouvées pour une partie sur le site Juliette Drouet, Lettres à Victor Hugo : http://www.juliettedrouet.org

/image%2F0944457%2F20240427%2Fob_648bee_j-ai-l-air-de-me-dissoudre-dans-le-cie.JPG)


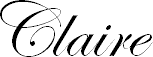








/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F47%2F45%2F1138952%2F121155297_o.png)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F09%2F95%2F1138952%2F119536328_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F72%2F02%2F1138952%2F118470886_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F80%2F82%2F1138952%2F118370888_o.jpg)